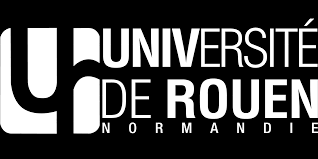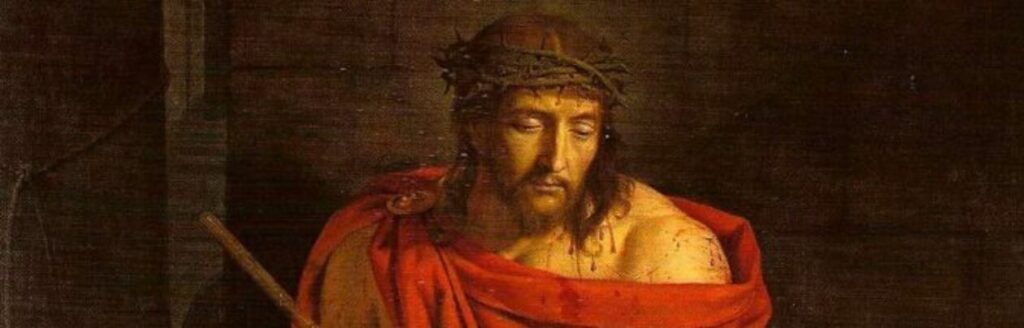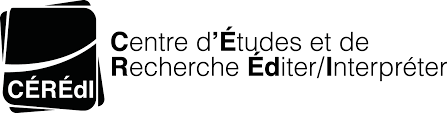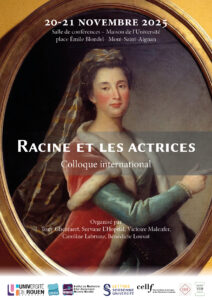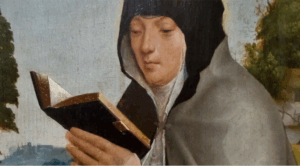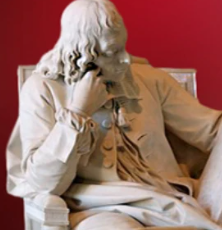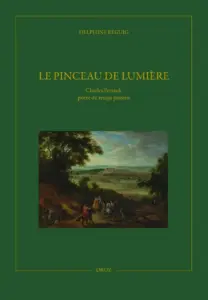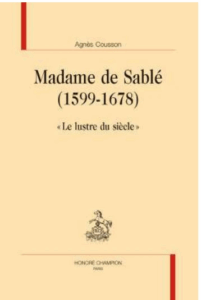Un siècle de reconquête
Le XVIIᵉ siècle s’ouvre sur une France encore travaillée par les guerres de Religion. Après l’assassinat d’Henri IV (1610), la pacification ne s’impose vraiment qu’avec le ministère de Richelieu : la prise de La Rochelle (1627-1628) affaiblit durablement les bastions protestants ; l’État renforce son autorité, l’Église sa discipline. Dans tout l’Occident catholique, c’est l’heure d’une réforme interne : moralisation du clergé, visites pastorales, séminaires, refondation de communautés, multiplication d’œuvres éducatives et caritatives. Mais cette reprise en main possède une face plus sombre: la “reconquête” catholique conjugue ferveur et contrainte. Les “déviances” sont réduites au silence ou ramenées à l’ordre ; les libertés d’expression religieuse, philosophique et festive se rétrécissent. C’est dans ce milieu disciplinaire, hérité de Trente et de ses indécisions sur la grâce, que s’inscrit la crise dite “janséniste”.
L’esprit de Trente
Le concile de Trente (1545-1563) n’a pas rétabli l’unité chrétienne, mais il a consolidé la doctrine catholique et relancé une réforme interne vigoureuse. D’où, au début du XVIIᵉ siècle, un net regain d’optimisme : fondations d’ordres, réforme des monastères, moralisation du clergé, essor d’une mystique exigeante. Les Visitandines, cofondées en 1610 par François de Sales et Jeanne-Françoise de Chantal (implantées à Paris en 1619), en sont un signe ; François de Sales conseille même Mère Angélique, à qui il écrit en 1619. Dans cette dynamique, les jésuites jouent un rôle de pointe (écoles, missions) et se distinguent par un vœu spécial d’obéissance au pape. Mais ils ne sont pas les seuls à porter l’esprit de Trente : le cardinal de Bérulle fonde l’Oratoire de France (1611) et impulse l’ »École française de spiritualité », courant majeur du siècle, souvent en dialogue (parfois en tension) avec la Compagnie.
Une zone d’ombre: la question de la grâce
La chrétienté a depuis toujours affirmé que le salut provient de deux causes: la grâce de Dieu (une force qui nous pousse à faire le bien) et la volonté humaine (notre propre sens moral, non lié directement à une action de Dieu, et qui détermine des bonnes actions). Or, les chrétiens, depuis le XVIe siècle, sont violemment divisés sur l’articulation de la grâce et de la volonté humaine. Trente a choisi de ne pas prendre position, pour éviter d’allumer des conflits.
- Trente affirme la nécessité de la grâce pour le salut et rejette les excès « pélagiens » (c’est-ç-dire les partisans d’une confiance exclusive dans les forces humaines) sans trancher entre les lectures augustiniennes strictes, selon lesquelles la grâce est vraiment « efficace » par elle-même, et les tentatives de conciliation de la liberté et de la grâce (on parlera plus tard de molinisme, du nom de la doctrine développée par Luis de Molina en 1588 dans sa Concordia).
- La querelle est relancée à Rome par la Congregatio de auxiliis (1597-1607), qui oppose dominicains (Bañez) et jésuites (Molina) : aucune décision définitive n’est prise.
Cette non-décision a des effets durables : elle permet des écoles concurrentes à l’intérieur du catholicisme. Au XVIIᵉ siècle, la publication de l’Augustinus (1640) de l’évêque d’Ypres Cornelius Jansen réactive une lecture très augustinienne de la grâce ; la condamnation en 1653 de cinq propositions implicitement attribués à Jansénius (Cum occasione) n’éteint pas le débat, qui se déplace alors sur le terrain des faits et des textes. C’est dans ce contexte que Port-Royal devient un foyer de controverses.
Une Église plus disciplinée… et des tensions gallicanes
Au lendemain de Trente, la cohérence doctrinale s’accompagne d’une discipline renforcée : pour éviter toute nouvelle dérive, les autorités traquent les opinions tenues pour suspectes ; la « clarification » produit de la censure et de l’intolérance. En France, cette politique passe par l’affirmation de l’autorité épiscopale (visites canoniques, réforme des maisons) et par l’organisation d’une formation du clergé dans des séminaires qui se multiplient à partir des années 1640.
Ce resserrement hiérarchique s’inscrit dans une ecclésiologie à tonalité monarchique, centrée sur Rome, mais il se heurte en France au gallicanisme, soucieux des « libertés » de l’Église du royaume. Depuis le concordat de Bologne (1516), le roi nomme aux évêchés (l’investiture canonique revenant au pape), ce qui rend aiguë l’articulation entre pouvoirs spirituel et temporel ; la fin du siècle réaffirme d’ailleurs ces prétentions gallicanes lors de l’Affaire des Quatre Articles en 1682.
Dans ce cadre, la foi se vit d’abord sous le régime de l’institution : participation aux sacrements et obéissance au clergé sont pensées comme conditions de l’ordre commun ; inversement, les foyers d’opposition sont vite lus comme des menaces pour la « tranquillité publique », appelant surveillances et interdictions.
Courants spirituels : l’ « humanisme dévot »
Dans ce climat, s’épanouit l’École française de spiritualité, d’abord autour de Bérulle, puis de ses successeurs Condren et Olier. On assiste alors à la floraison d’un courant que Henri Bremond appellera plus tard, au début du XXe siècle l’humanisme dévot, caractérisé par :
- la confiance dans les ressources de l’âme convertie,
- la valorisation des affections,
- l’usage des arts (images, décors, musique) au service de la dévotion.
Face au pessimisme anthropologique de certaines lectures luthériennes ou calviniennes, qui professent la corruption radicale de l’homme et l’impuissance de la volonté), de nombreux catholiques, jésuites en tête, insistent sur la coopération de l’homme à l’œuvre de Dieu : Dieu donne à toutes et tous une grâce suffisante, estiment-ils, en s’appuyant sur saint Paul (« Pro omnibus mortuus est ») ; accueillie librement, elle devient efficace. Les adversaires y voient une pente « semi-pélagienne », c’est-à-dire qui accorde trop de place à l’homme, et à ses bonnes actions réalisées sans l’aide de Dieu, dans le processus du salut ; les partisans de la grâce suffisante considèrent au contraire que la valorisation de ces facultés humaines sont fidèles aux enseignements de Trente et à la pastorale.
Les continuités augustiniennes
Reste que l’Occident chrétien demeure profondément augustinien : la primauté de la grâce n’est ni neuve ni propre aux réformés. Au XVIIᵉ siècle, nombre de catholiques revendiquent Augustin tout en récusant Calvin. La crise janséniste est une crise intra-catholique : elle oppose des manières rivales d’interpréter la grâce, toutes soucieuses d’orthodoxie, dans un cadre institutionnel qui, depuis Trente, tolère ces divergences sans les arbitrer définitivement.
Port-Royal, du centre à la marge
C’est du silence de l’Eglise post-tridentine qu’est née la crise « janséniste » :
- Il explique comment une abbaye d’abord célébrée pour sa réforme et sa ferveur devient, aux yeux de certains, suspecte: non par rupture brutale avec le catholicisme, mais par fidélité à une lecture d’Augustin jugée trop rigoureuse par d’autres.
- Il éclaire la longévité des controverses : tant que l’articulation grâce/liberté reste ouverte, pédagogie, direction spirituelle, théologie et politique ecclésiale s’y heurtent.
- Il situe Port-Royal au croisement de la Réforme catholique (discipline, écoles, traductions, images) et d’une exigence doctrinale qui entend rester fidèle au « docteur de la grâce ».