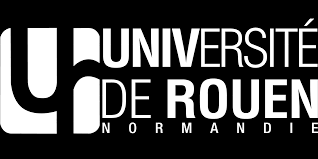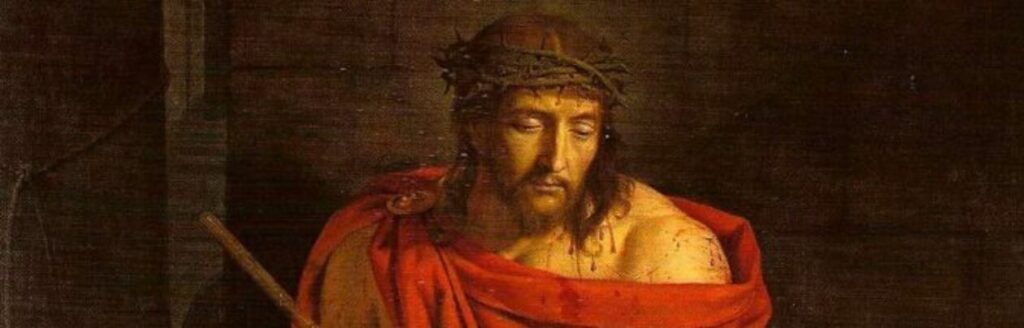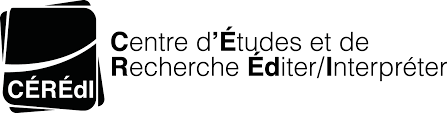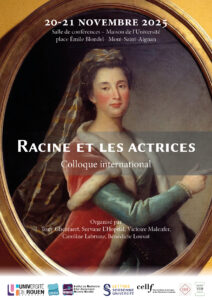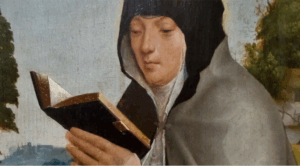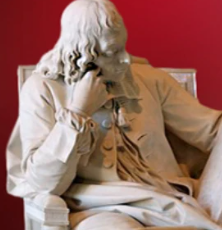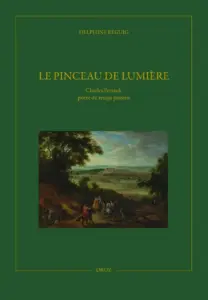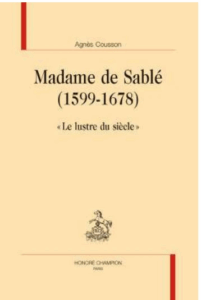Des jardins monastique aux vergers des Solitaires
Dès l’époque moderne, Port-Royal des Champs s’organise autour de jardins « utiles » au service de la communauté : potager, jardin médicinal (le « jardin des simples »), bouquetier pour l’ornement de l’autel, auxquels s’ajoutent aujourd’hui des « jardins d’évocation » créés en 2004 pour rappeler ces usages monastiques. Le musée indique en outre la présence d’un rucher pédagogique, qui prolonge l’ancien travail des religieuses sur la cire et le miel.
A partir du retour des religieuses en 1648, les Solitaires s’installent « aux Granges » et prennent en main, jour après jour, la bonne marche de l’exploitation : la ferme reste tenue par du personnel agricole, mais l’ensemble des travaux est suivi de près par les Messieurs, qui consacrent deux à quatre heures quotidiennes aux tâches manuelles (travail de la terre, entretien des bois et des étangs, soins du jardin), dans l’esprit de silence et de régularité voulu par Saint-Cyran. On voit aussi les pénitents prêter la main aux nécessités les plus prosaïques de la maison : ainsi, dans les années 1670, Paul-Gabriel de Gibron se fait littéralement « cuisinier des habitants de la ferme des Granges », signe d’une participation directe aux services communs. L’organisation agricole et horticole apparaît donc comme une intendance partagée : personnel de ferme et « frères » laïcs coopèrent, les seconds fixant l’orientation, surveillant l’exploitation et assumant eux-mêmes une part des travaux (jardin, verger, vignes), conformément à l’idéal laborieux de Port-Royal.
Une expérience horticole
Figure majeure des Granges, d’Andilly s’y retire vers 1645 ; passionné d’arboriculture, se réserve plus spécialement la conduite des jardins et du verger « d’en haut », aménagés au pied des Petites-Écoles sur le plateau, tandis qu’une vigne est plantée sur le coteau descendant vers l’abbaye ; ces cultures forment avec les potagers un ensemble cohérent qui répond à la fois aux besoins et au programme spirituel des retraites.
Les sources locales permettent de préciser l’ordonnance originelle : environ 60 ares divisés en huit carrés plantés, ceints de quatre murs dont l’orientation commandait la répartition des variétés, avec des allées assez larges pour la circulation des charrettes. Ces données sont cohérentes avec la pratique savante exposée dans La manière de cultiver les arbres fruitiers (première édition 1652), publiée sous le pseudonyme d’abbé Legendre et autrefois attribuée à Arnauld d’Andilly (il semble bien ne pas en être l’auteur).
Recréé à la fin des années 1990 par Sylvain Hilaire, le verger présente aujourd’hui plusieurs dizaines d’espèces anciennes (notamment poiriers, pruniers, pêchers) et fait l’objet d’animations de taille « à l’ancienne » portées par l’association des Amis du dehors.
La vigne au flanc du coteau
Sur le flanc qui relie les Granges à l’abbaye (l’ancien escalier des « Cent marches »), le coteau était au XVIIᵉ siècle « entièrement planté en vignes ». Une vigne pré-phylloxérique sur pieds francs y a été partiellement restituée grâce à un mécénat récent, rappelant la place de la viticulture dans l’économie du site.
Du côté des jardins d’utilité, le musée a reconstitué in situ un jardin médicinal proche de l’ancienne infirmerie et maintient un rucher ; ces dispositifs, avec le potager d’évocation, offrent un cadre pédagogique pour comprendre l’alimentation, les pratiques de soin et le quotidien d’une abbaye cistercienne.