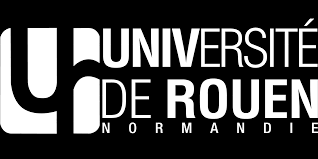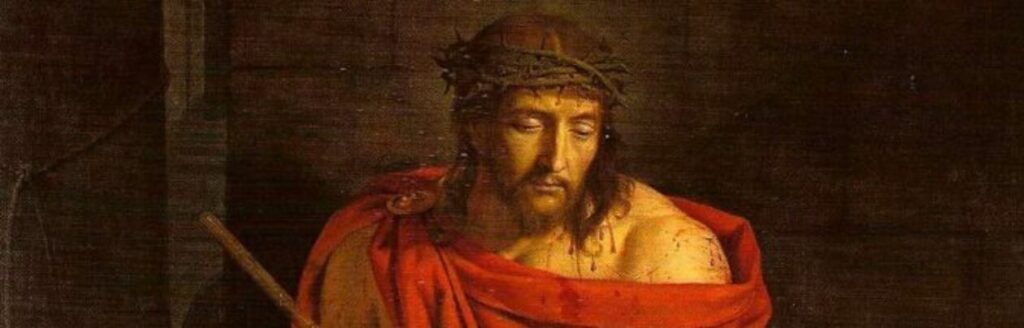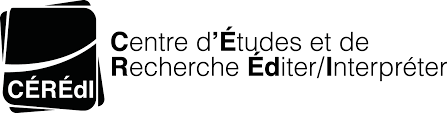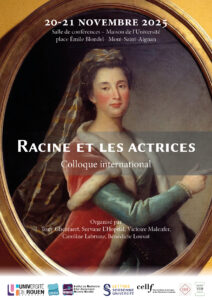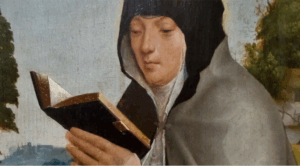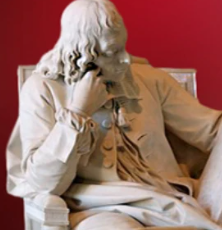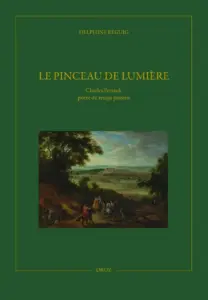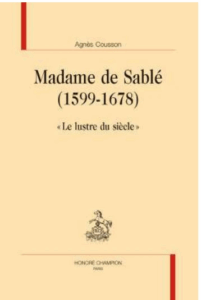Dès 1637, sous l’impulsion de l’abbé de Saint-Cyran, Antoine Singlin réunit les premiers élèves ; une messe est attestée le 10 août 1637, date qui marque symboliquement la naissance des Petites Écoles. L’expérience s’inscrit dans un contexte plus large : à Paris, la moitié des paroisses disposaient déjà d’écoles de « charité » ; mais celles de Port-Royal se rapprochaient davantage des écoles privées payantes autorisées par le chantre de Notre-Dame et le lieutenant civil du Châtelet.
Le projet de Saint-Cyran était clair : il fallait préserver les enfants des dangers spirituels des collèges ordinaires, jugés corrupteurs, et leur offrir une éducation adaptée à leur baptême plus qu’à leur naissance sociale. Pierre Thomas du Fossé rapporte que Saint-Cyran voyait dans l’éducation chrétienne des enfants une charité presque aussi haute que celle qui conduit à donner sa vie pour ses frères.
Un recrutement choisi
Contrairement à l’image d’une école ouverte à tous, les débuts ressemblent à un préceptorat familial réservé aux proches du mouvement. Ainsi, en 1637, Jérôme Ier Bignon confia à Singlin l’éducation de ses deux fils, contre une pension de 2000 livres. En 1640-1642, on trouve déjà aux Champs des enfants de Robert Arnauld d’Andilly, de Madame de Saint-Ange, de Gentien Thomas du Fossé ou encore de Jean Hamelin.
Jean Racine, orphelin en 1649, fut confié dès 1646 à Antoine Le Maistre, parent de sa famille maternelle, et rejoignit les écoles de Paris puis celles des Champs.
Organisation et pédagogie
L’implantation parisienne (cul-de-sac Saint-Dominique, 1646) permit d’élargir l’expérience : sous la direction de Charles Wallon de Beaupuis, des maîtres tels que Claude Lancelot, Pierre Nicole, Pierre Coustel, Thomas Guyot enseignaient à des groupes de quatre à six enfants.
La méthode pédagogique se distinguait :
- enseignement par le français, et non par le latin ;
- effectifs réduits, avec une relation presque préceptorale ;
- absence de châtiments corporels, remplacés par une discipline ferme mais respectueuse ;
- usage de supports originaux, comme les « cartes historiques » ou l’apprentissage par le jeu.
Expansion et limites
Outre Paris, des maisons furent ouvertes au Chesnay (chez Charles Maignart de Bernières, 1653) et aux Troux (chez Du Gué de Bagnols, 1652). Aux Champs, un bâtiment spécifique fut construit en 1651-1652, aujourd’hui connu comme le bâtiment des Petites Écoles.
Au total, l’expérience concerna environ 300 enfants issus de familles alliées au réseau dévot (bien moins qu’on ne l’a souvent imaginé, mais leur qualité et leur postérité donnèrent à l’école une aura exceptionnelle (Racine, Tillemont, Boisguilbert, etc.).
Fermeture
Le conflit janséniste scella le destin de l’institution. Après des premières dispersions en 1656, une déclaration royale du 7 juin 1659 ordonna leur suppression. Le 11 mars 1660, un ordre de police ferma définitivement les Petites Écoles. Les maîtres continuèrent alors leur activité comme précepteurs dans des familles nobles ou bourgeoises, perpétuant ainsi l’esprit pédagogique de Port-Royal.