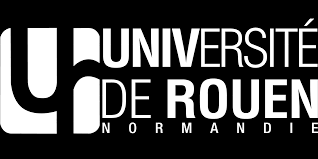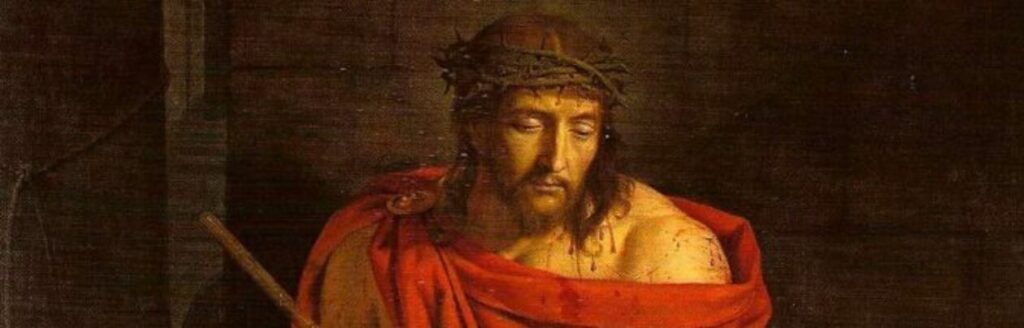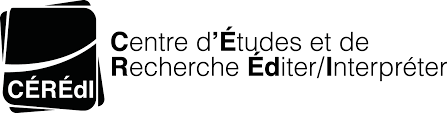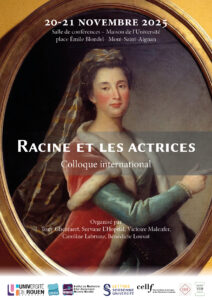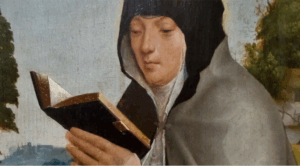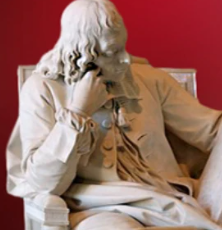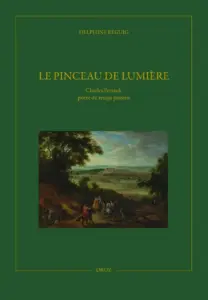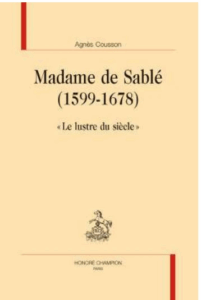Ce qui subsiste aujourd’hui, dans la vallée de Chevreuse, de ce haut lieu de spiritualité et de vie intellectuelle, ce sont des traces organisées en un paysage de mémoire : les fondations de l’église abbatiale matérialisant encore la nef et le chœur des moniales ; des vestiges du cloître (leur emplacement est figuré par un carré de tilleuls) ; le vivier et la grande digue ; l’ancien moulin remanié au XIXᵉ siècle ; le pigeonnier médiéval ; quelques tronçons de murs et de tourelles. Le parcours de visite actuel, établi par le musée, décrit précisément ces éléments et en restitue la topographie : église (nef de 55m, plan en croix latine, style gothique « archaïque »), bâtiments conventuels rasés, vivier, « Solitude », oratoire du XIXᵉ siècle, etc. (voir le site du Musée de Port Royal des Champs)
De l’extinction du monastère à l’effacement matériel (1708-1713)
À la suite de la bulle Ad instantiam regis (27 mars 1708), qui préparait la suppression du monastère des Champs, l’archevêque de Paris prononce, le 11 juillet 1709, l’extinction de l’abbaye ; le 29 octobre, les religieuses sont expulsées et dispersées.
Le 22 janvier 1710, un arrêt du Conseil ordonne la démolition des bâtiments « à l’exception de l’habitation du chapelain, de la ferme, du moulin et du colombier » ; dans les mois qui suivent, on voit des familles obtenir l’autorisation de transférer la dépouille de leurs proches (ainsi celles des Arnauld) avant les exhumations générales.
L’ordre d’exhumer « les corps enterrés dans l’église, le cloître, le chapitre et les cimetières » date de 1710, mais l’exécution n’a lieu qu’en novembre-décembre 1711. Les contemporains parlent de « trois mille corps » tirés des cimetières et conduits en fosses communes au cimetière de Saint-Lambert ; d’autres dépouilles (corps ou cœurs) rejoignent l’église de Magny-les-Hameaux. La chronologie et les lieux de réinhumation sont précisés par les sources modernes comme par le musée (Port Royal des Champs)
La destruction de l’église abbatiale, d’abord ajournée, intervient ensuite entre l’automne 1712 et le printemps 1713. Cette fourchette est aujourd’hui reprise par les historiens et par le musée (qui illustre, dans ses collections, ces deux épisodes qu’un peintre a réunis en une scène).
Un épisode particulier a frappé les esprits : dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 décembre 1711, les corps de Lemaistre de Sacy, d’Antoine Le Maistre et de Jean Racine sont transférés à Saint-Étienne-du-Mont, sur autorisation du cardinal de Noailles.
Ce que montrent les textes : gestes, symboles, récits
Les témoignages contemporains insistent sur l’inhumanité et la profanation des exhumations : fossoyeurs ivres, chiens errants dans l’église, imagerie biblique de la « ruine de Jérusalem » appliquée à Port-Royal. Philippe Luez rappelle comment les Gémissements (attribués à l’abbé d’Étemare) orchestrent cette référence scripturaire, reprise encore en 1809 par l’abbé Grégoire dans ses Ruines de Port-Royal.
L’historiographie a aussi gardé le souvenir de pratiques « de piété des ruines » : pèlerinages, collecte de pierres ou de terre, tombes vendues comme dalles de récupération, signe paradoxal de l’effacement et de la survivance.
Ce qui reste à voir aujourd’hui
- Les fondations de l’église : le plan est lisible au sol, avec le chœur des moniales encore perceptible.
- Les bâtiments conventuels : rasés en 1711 ; des fouilles (2007) ont restitué des structures médiévales (salle du chapitre, dortoir reconstruit vers 1650).
- Le vivier, la digue et l’ancien moulin : système hydraulique cistercien (moulin très remanié au XIXᵉ s., bief conservé en sous-sol).
- Le pigeonnier (XIVᵉ-XVIᵉ s.) : rare témoin en élévation, dont la taille dit l’importance du domaine.
- La « Solitude » (évocation du XIXᵉ s., sur bases d’une tour de 1651) et l’Oratoire (musée néo-gothique, 1891) ne sont pas des monuments ayant échappé à la ruine, mais ils sont des marqueurs essentiels du travail mémoriel du XIXᵉ siècle.
Une mémoire durable
Dès le XVIIIᵉ siècle, des textes et des images font des ruines un lieu de méditation et de transmission : les Gémissements de Le Sesne d’Etemare, les Mémoires sur la destruction, puis, au XIXᵉ, le texte de l’abbé Grégoire et le grand récit de Sainte-Beuve. Cette « poétique des ruines » a contribué à déplacer l’attention, du conflit théologico-politique vers la réflexion sur la fragilité des institutions et la persistance des œuvres spirituelles et littéraires.
Repères de chronologie (synthèse)
- 27 mars 1708 : bulle pontificale préparant la suppression des Champs.
- 29 octobre 1709 : expulsion des religieuses.
- 22 janvier 1710 : arrêt du Conseil ordonnant la démolition (avec exceptions).
- Nov.–déc. 1711 : exhumations ; transferts à Saint-Lambert et à Magny.
- Sept. 1712 – juin 1713 : démolition de l’église.
La destruction de Port-Royal selon Sainte-Beuve
«Qu’ on se rappelle ce qui s’ était passé depuis tant d’ années que nous étudions port-royal et que nous y habitons, la quantité de corps, d’ entrailles, de coeurs, que la piété des fidèles y avait envoyés reposer comme en une terre plus sainte. On a évalué à plus de trois mille les corps qui, déposés dans la suite des générations, durent être ainsi exhumés inhumainement. Pour quelques-uns que la religion des héritiers ou des amis vint revendiquer et choisir, combien de hasard et de pêle-mêle ! Qu’ attendre des hommes grossiers chargés de déterrer confusément les corps, et de les porter en tas dans des tombeeaux au cimetière voisin de saint-Lambert ? Il y avait bien un prêtre, M Le Doux, de Saint-Nicolas De Chardonnet, chargé par le cardinal de Noailles de veiller à ce que les choses se passassent convenablement ; mais que pouvait-il seul, souvent absent, et eût-il été présent, sur des hommes brutaux et qui s’ enhardissaient par l’ ivresse à leur dégoûtante besogne ?
Ainsi ce qui avait été la vallée sainte par excellence et la cité des tombeaux n’ offrit plus, durant ces mois de novembre et de décembre 1711, que la vue d’ un immense charnier livré à la pioche et aux quolibets des fossoyeurs.
[…]
Mais je n’ ai plus trouvé qu’ un horrible mélange
D’ os et de chair meurtris et traînés dans la fange,
Des lambeaux pleins de sang, et des membres affreux
Que des chiens dévorants se disputaient entre eux.
[…]
Cette fin du songe d’ Athalie se vérifia à la lettre. Des chasseurs, qui traversèrent alors le vallon, ont raconté qu’ ils furent obligés d’ écarter avec le bout de leurs fusils des chiens acharnés à des lambeaux. Comment s’ étonner, après cela, que la réaction morale causée par ces horreurs suscite des fanatiques, et que le gémissement d’ abord, le sanglot, puis la convulsion saisisse ceux qui sont trop violemment indignés ! Grâce à une incurie sans nom succédant à de longues suggestions iniques, il y eut sous Louis XIV, à deux pas de Versailles, des actes qui rappellent ceux de 1793. On le lui rendit trop bien à ce superbe monarque, et à toute sa race, le jour de la violation des tombes royales à Saint-Denis ! Dernier trait de profanation : plusieurs des tombes des religieuses, qui étaient des losanges fort larges de marbre noir ou de pierre de liais, furent trouvées dans des cabarets et des auberges, à quelques lieues aux environs, y servant de pavés ou même de tables à boire dans la cour. Des passants scandalisés en rachetèrent quelques-unes.»
C.-A. de Sainte-Beuve, Port-Royal, dernière partie.