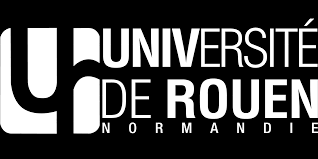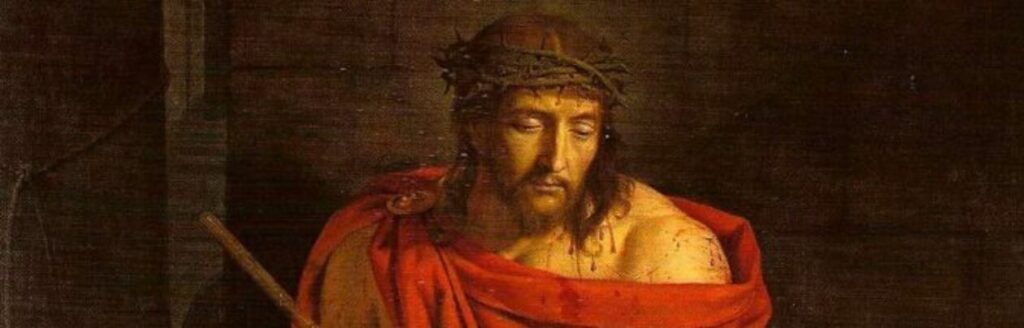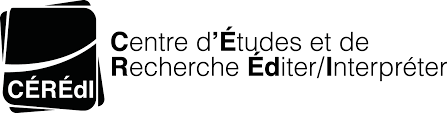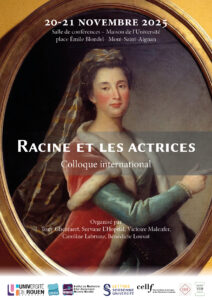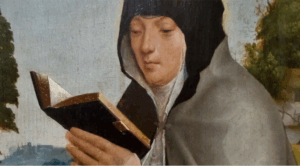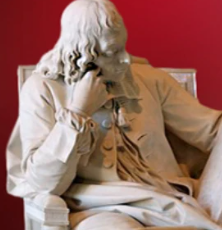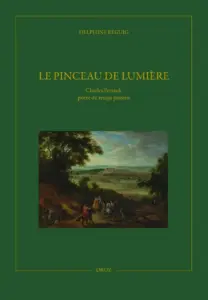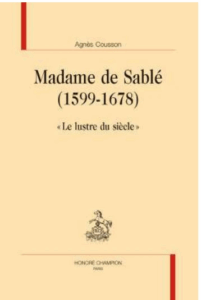Le Nécrologe de Port-Royal atteste des liens profonds qui unissent ce peintre au monastère de Port-Royal:
Ce même jour (12 août 1674) mourut à Paris Philippe de Champaigne, natif de Bruxelles, qui s’était acquis une grande réputation par son habileté dans l’art de la peinture; mais qui s’est rendu encore plus recommandable par sa piété. Il a toujours été fort attaché à ce monastère, où il avait une fille religieuse, et dont il avait épousé les intérêts, qu’il a soutenus en toute occasion, souvent même au préjudice des siens et de sa propre tranquillité.
Les religieuses de Port-Royal ont conservé la mémoire de Champaigne comme d’un « bon peintre et bon chrétien », attaché de cœur et d’actions au monastère ; l’« obituaire » de l’abbaye souligne, à sa mort en 1674, sa fidélité au lieu et aux religieuses. Dès le milieu du siècle, ses rapports avec Port-Royal se resserrent : en 1646 il entre en relation avec l’abbaye ; en 1648, il place ses deux filles pensionnaires au couvent du faubourg Saint-Jacques, et l’aînée, Catherine, fait profession le 14 octobre 1657 sous le nom de sœur Catherine de Sainte-Suzanne.
Sans doute la vie et la carrière de Philippe de Champaigne sont-elles loin de se limiter à ses travaux pour l’abbaye de Port-Royal, mais c’est pour le milieu augustinien qu’il peignit quelques-uns de ses tableaux les plus importants: portraits de Saint-Cyran et de Mère Angélique, ou Ex-voto de 1662, conservé au Musée du Louvre, et représentant la mère Agnès Arnauld en compagnie de la Soeur Catherine de Sainte-Suzanne Champaigne, guérie miraculeusement, à Port-Royal de Paris, le 7 janvier 1662, d’une paralysie de 14 mois. Le tableau, offert par Philippe de Champaigne, orna successivement l’abbaye de Paris, puis celle des Champs.
La place occupée par Philippe de Champaigne à Port-Royal montre que, mieux qu’aucun autre, il a compris les leçons de cette théologie de l’art. Bien qu’il n’ait jamais peint exclusivement pour le monastère, il y fut profondément attaché; marqué par une série de deuils, il respectait l’esprit de renoncement et de pauvreté des religieuses de Port-Royal comme des chartreux de saint Bruno. Aussi n’est-il pas surprenant qu’il mît souvent ses pinceaux à leur service.
Au-delà des seules commandes pour l’abbaye, Champaigne élabore, au contact des milieux augustiniens, un classicisme de la vérité : coloris resserré, silence des gestes, primat de la composition et du dessin. L’iconographie n’y est jamais gratuite : elle engage le spectateur dans l’acte même de la foi (ainsi l’Ex-voto, pensé comme action de grâce publique), tout en répondant aux exigences spirituelles des religieuses et de leurs amis. Les notices du Louvre et la lecture historiographique récente convergent : loin d’un iconoclasme imaginaire, Port-Royal a encouragé les images capables de soutenir l’oraison et la méditation, et Champaigne en fut l’interprète le plus sûr.
[Source: Sandrine Lely, « Architecture et peinture à Port-Royal des Champs », in Chroniques de Port-Royal – Port-Royal des Champs, 54, 2004; et Jean Lesaulnier, « Petite galerie des personnages illustres », in Chroniques de Port-Royal – Port-Royal de Paris, 1991.]