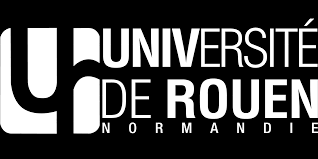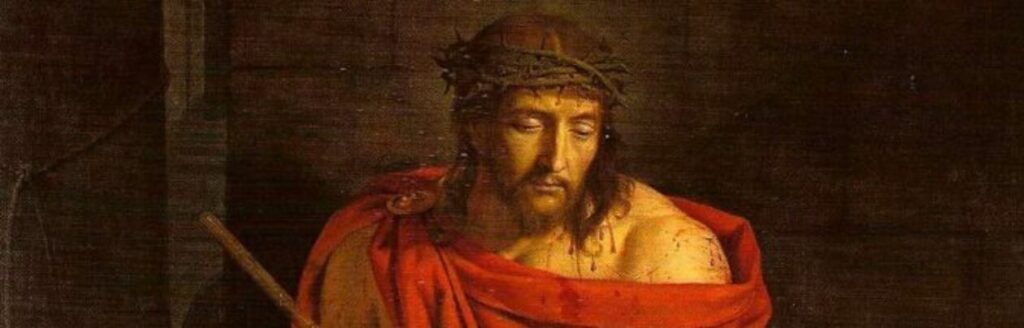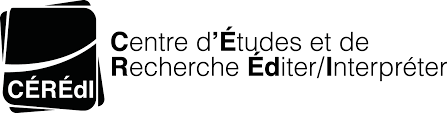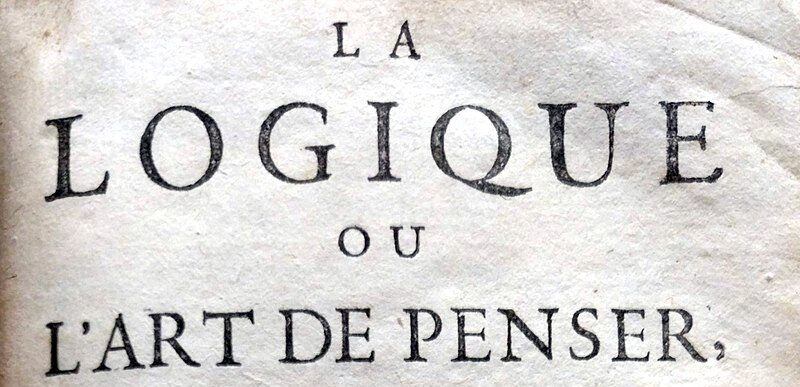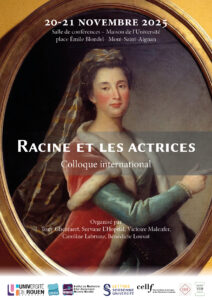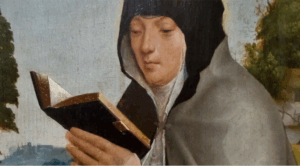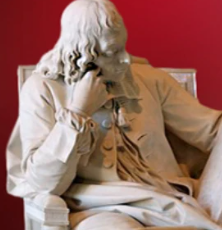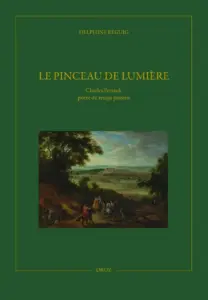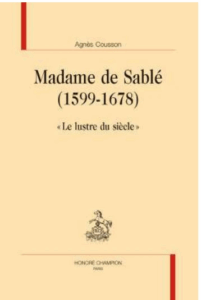Port-Royal pense l’écriture comme un exercice de vérité. C’est dans cette perspective que Les Messieurs s’employèrent à réformer la langue, pour la placer sous le signe de la clarté, de l’ordre, et de la pertinence logique; mais ils manifestèrent aussi un souci des langues, anciennes (grec et latin) et vivantes.
Une conception rationnelle de la langue
Sur le versant théorique, la Grammaire générale et raisonnée (Arnauld & Lancelot, 1660) cherche la raison du discours plutôt que « l’usage » seul.
La Grammaire décrit les catégories morpho-syntaxiques à partir des opérations de l’esprit et ouvre la voie à une écriture claire, transparente, non décorative. La rhétorique n’est pas bannie, mais subordonnée à la justesse du jugement. Port-Royal s’écarte ainsi des grammairiens de « l’usage » (Vaugelas, Ménage, Patru, Bouhours) en cherchant la raison du discours : au-delà des tours particuliers, quelles structures communes rendent la langue conforme à la pensée ? Les grammairiens, en tentant de répondre à cette question, développent une branche cartésienne que Descartes lui-même avait délaissé et qui se prolongera au XVIIIe siècle chez Du Marsais, Duclos, Condillac ou Destutt de Tracy.
Le projet de « Grammaire générale » est plus « logicien » que normatif. Il définit les parties du discours à partir d’une raison commune et pensée comme universelle, non à partir d’un simple relevé d’exemples. D’où l’originalité d’Arnauld, « classificateur par voie de raison » (Sainte-Beuve), qui applique ensuite ses principes aux langues particulières.
Cette ambition apparaît jusque dans les échanges d’Arnauld avec l’Académie française (1659) : plutôt que de régler des tours de français, il la prie de se prononcer sur des questions de grammaire générale (verbe, relatif, infinitif…), estimant que « le discours n’étant que l’image de la pensée », il faut en éclairer les fondements .
Cette conception entraîne, sur le plan pratique, un renouvellement méthodologique dans l’apprentissage des langues vivantes. Lancelot publie ainsi un Jardin des racines grecques, et de « nouvelles méthodes » pour apprendre l’italien, l’espagnol, etc.
La Logique de Port-Royal
La Logique ou l’Art de penser (Arnauld & Nicole, 1662) et la Grammaire générale et raisonnée forment un diptyque inséparable. La seconde décrit, dans les langues particulières, ce que la première établit dans l’ordre de l’esprit. Le principe commun est clair : le discours n’est que « l’image de la pensée ». D’où une priorité accordée non à la compilation d’usages, mais à l’explication des opérations qui rendent un énoncé intelligible : concevoir, juger, raisonner, ordonner. La grammaire est ainsi une logique incarnée ; la logique, la charpente conceptuelle de la grammaire.
La Logique commence par une théorie des idées : claires ou confuses, distinctes ou obscures, elles possèdent une extension (ce à quoi elles s’appliquent) et une compréhension (leurs notes constitutives). La Grammaire en donne la traduction formelle : noms, articles et adjectifs servent à borner l’extension et à préciser la compréhension. Toute « définition » bien faite dans la Logique devient, côté langue, un art de déterminer correctement le référent (articles définis/indéfinis, génitifs, expansions nécessaires), et un soin des relatifs qui précisent la relation (identification, possession, cause, lieu). La conséquence stylistique s’ensuit : les Messieurs affectionneront une prose qui préfère le terme propre à la périphrase ornementale, parce qu’un mot n’avance que ce qu’il peut garantir.
Vient ensuite le jugement, qui consiste à lier ou délier des idées. La Logique montre combien d’erreurs tiennent à des confusions de termes (amphibologie, équivoque) ; la Grammaire, symétriquement, règle la construction : concordances, régimes, ordre « naturel » sujet-verbe-objet et déplacements motivés. Il ne s’agit pas de bannir l’inversion, mais de la subordonner à la hiérarchie des dépendances : on montre qui régit quoi avant d’orner l’énoncé. Là encore, l’effet stylistique est décisif : la période port-royaliste se reconnaît au calme de sa syntaxe, qui réduit l’ambiguïté par la structure, non par l’emphase.
Le troisième moment est celui du raisonnement. Enchaîner des jugements, c’est ordonner des raisons : définir, distinguer, prouver, en évitant sophismes et pétitions de principe. La Grammaire en fournit l’outillage : conjonctions et adverbes de liaison (car, donc, puisque, néanmoins, ainsi) ne sont pas des bijoux ajoutés après coup, mais les charnières visibles de l’architecture argumentative. Les relatives déterminatives ou explicatives organisent l’inclusion et l’annexe ; la ponctuation elle-même traduit la logique (hiérarchie des propositions, segments incidents). D’où une règle pratique, constante à Port-Royal : on n’emploie un connecteur que pour marquer un rapport de pensée effectivement soutenu ; le pathétique suit la preuve, il ne la remplace pas.
Les temps et modes offrent un terrain d’observation privilégié de ce parallélisme. Pour la Logique, ils modulent la portée du jugement : assertion, hypothèse, antériorité, éventualité. La Grammaire en tire des choix motivés : indicatif après « après que » (pour marquer une relation d’antériorité accomplie), subjonctif dans l’hypothétique et l’éventuel ; et ce « ne » dit « explétif » qui n’est pas négatif, mais marque une restriction ou une appréhension d’ordre logique. À cet endroit se voit la différence d’accent avec une police de l’usage à la Vaugelas : l’usage compte, mais subordonné à l’intelligibilité. Quand l’usage hésite, la valeur logique tranche ; quand il est stable et clarifiant, la grammaire l’entérine.
Cette réciprocité entre Logique et Grammaire culmine dans la méthode. La Logique ordonne l’exposé par analyse (remonter des effets aux principes) et synthèse (descendre des principes aux conséquences), en recommandant de conduire du simple au composé, du clair au moins clair. La Grammaire traduit ces impératifs dans la phrase : préparer les termes avant de conclure, ménager des transitions nettes, éviter les inversions gratuites, dimensionner la période à la capacité de rétention du lecteur. C’est exactement ce que donnera à lire la meilleure prose « de Port-Royal » : sobriété des moyens, exactitude lexicale, transparence des articulations. Non un minimalisme, mais une probité stylistique : l’ornement vient après la pensée.
Cette matrice a irrigué l’écriture polémique (les Provinciales, où définition, distinction et preuve gouvernent l’ironie) comme l’essai moral chez Nicole. Elle explique aussi la résistance, souvent mal informée, d’un Henri Bremond contre un prétendu « style sec » de Port-Royal : ce qu’il juge pauvreté est en réalité réserve et convenance, c’est-à-dire la décision de ne rien concéder au flou quand la chose peut être pensée nettement.
Enfin, l’histoire a confirmé l’unité des deux traités : Du Marsais, Condillac, les Idéologues hériteront à la fois de la logique d’analyse et de l’attention aux formes ; le XVIIIe siècle prolonge ainsi ce couple théorie/forme sans les dissocier. Si l’on devait résumer en une formule : la Logique et la Grammaire apprennent ensemble à définir juste, distinguer net, prouver clairement ; et c’est de cette solidarité que naît ce que l’on peut appeler, sans fétichisme, un style Port-Royal.