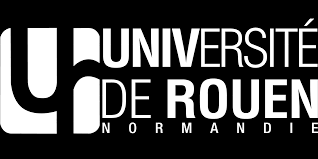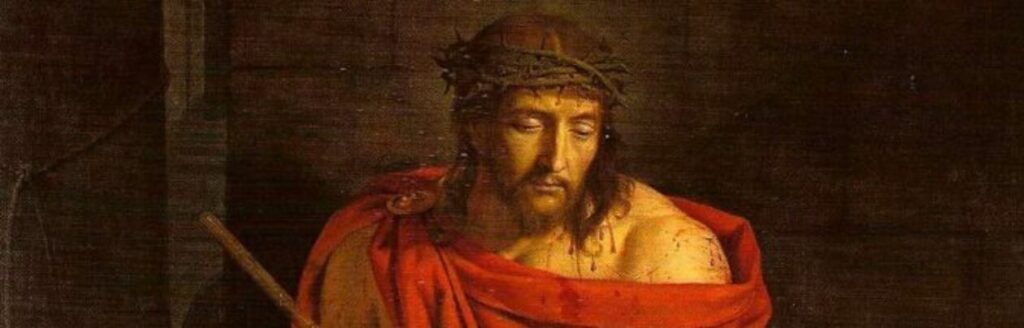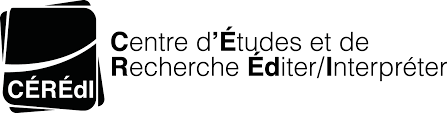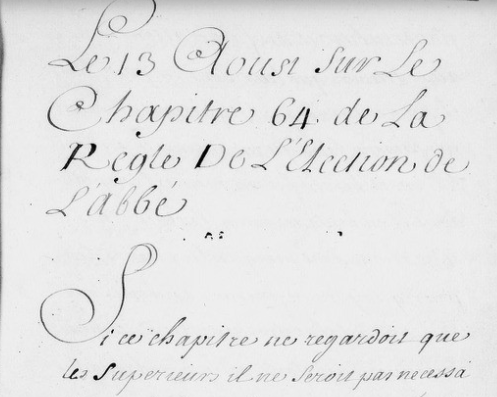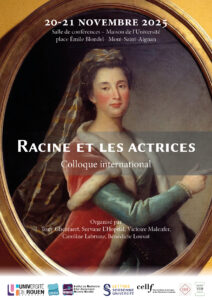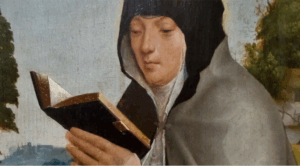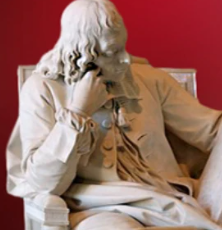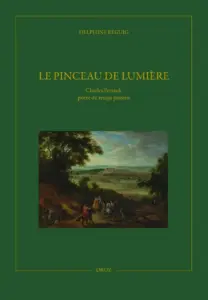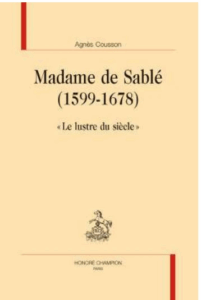Sur le terrain du style, Port-Royal privilégie la clarté déductive et la rigueur, au risque d’amenuiser l’ « enjouement » et les idiotismes que l’Académie goûtait chez les maîtres de l’usage. Cette rhétorique de la vérité n’a rien d’ornemental : elle vise le discernement, la justesse des définitions et la convenance des preuves. L’ascèse de la parole (cohérence de la pensée, sobriété persuasive, refus de l’amplification gratuite) procède d’un choix spirituel autant que d’une esthétique.
Henri Bremond, dans son Histoire littéraire du sentiment religieux très hostile à Port-Royal, a dénoncé un style « janséniste » qu’il jugeait sec ou appauvri. En réalité, cette sobriété et cette mesure visent une éthique de la prose. Ce « style de Port-Royal » n’est pas la négation du beau, mais la recherche d’un beau de vérité, caractérisé par la clarté argumentative, l’exactitude lexicale, l’ordonnancement logique, et une discrétion oratoire répugnant à l’émotion et au pathétique outrés.
S’articulent, à Port-Royal, trois gestes indissociables : former l’âme et le jugement (pédagogie), rendre raison des formes du dire (grammaire), régler l’acte de persuader par la vérité (rhétorique). De là naît une pratique de l’écriture qui, des classes au cabinet, conçoit le style comme une éthique : l’expression n’y vaut qu’à proportion de la justesse qu’elle sert.