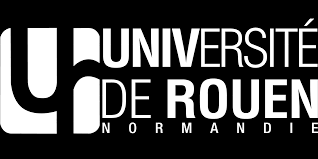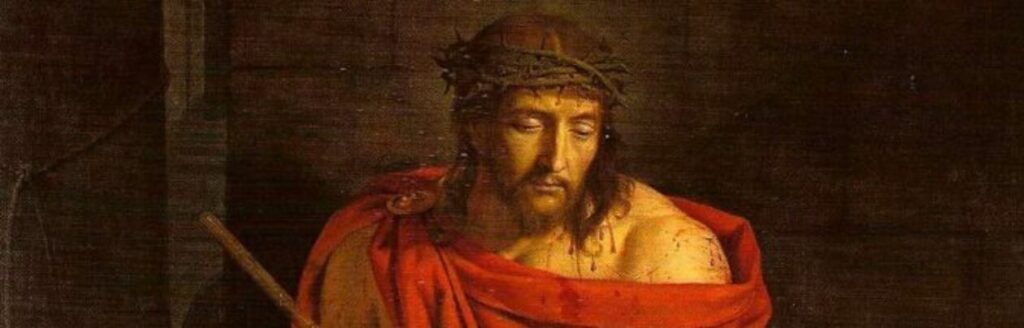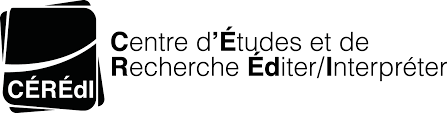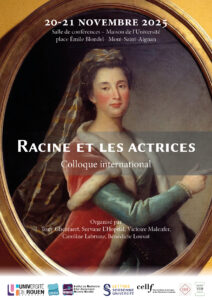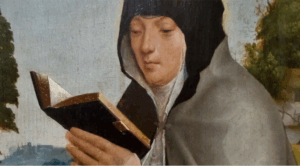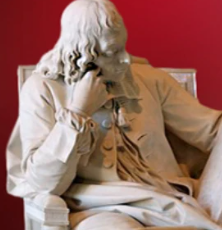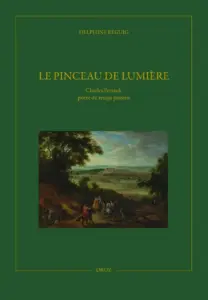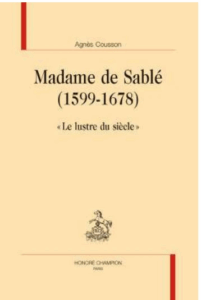À l’origine simple exploitation agricole relevant de l’abbaye cistercienne fondée en 1204, les « Granges » constituent, au XVIIᵉ siècle, la principale ferme de rapport de Port-Royal des Champs, située sur le plateau au nord du vallon monastique. Les sources décrivent un vaste domaine : outre les bâtiments d’exploitation, on y compte plusieurs centaines d’arpents de terres labourables et de bois (environ 380 arpents cultivés à la fin du XVIIᵉ siècle, plus de 900 arpents de bois), ce qui en fait un ensemble agricole de premier plan pour l’abbaye.
Des travaux des champs aux « Solitaires » (années 1640-1660)
À partir de 1648, la ferme abrite, aux côtés du personnel agricole, les « Solitaires » ou « Messieurs » de Port-Royal. Ils s’installent dans la maison alors existante et, en 1651-1652, font édifier de nouveaux corps de logis : un « petit corps de logis » en brique et pierre, puis un « grand logis » destiné d’abord à accueillir des visiteurs pieux, bientôt adapté pour loger une partie des élèves des Petites Écoles (une vingtaine pendant deux ou trois ans), parmi lesquels Jean Racine.
Le travail agricole structure la vie quotidienne : surveillance étroite de l’exploitation, soins apportés aux jardins, et vigne plantée « enclosée » sur le coteau descendant vers l’abbaye. Les textes évoquent précisément un clos de vignes et d’arbres fruitiers aménagé le long de la pente, tandis qu’un potager et un verger sont développés au pied des Petites Écoles.
Dans ce cadre, les Granges deviennent un foyer d’étude : traductions et éditions des Pères au service d’un christianisme lisible par les laïcs (Le Maistre de Sacy, Arnauld, Nicole, Lancelot, Robert Arnauld d’Andilly) ; essor pédagogique des Petites Écoles ; et une vie spirituelle intense dont témoignent les récits contemporains.
Disparition du monastère et destin des Granges (XVIIIᵉ-XXᵉ siècles)
Après l’expulsion des religieuses (1709) et la destruction ordonnée du monastère (1711-1712), le site est démantelé ; mais la ferme du plateau demeure exploitée.
À la Révolution, Port-Royal des Champs est vendu en lots distincts : les ruines de l’abbaye d’un côté, les Granges de l’autre ; un agriculteur acquiert ces dernières en 1791, tandis que l’abbaye revient à une autre propriétaire.
Au XIXᵉ siècle, la propriété change plusieurs fois de mains. En 1896, la famille Goupil fait édifier, à l’équerre des Petites Écoles, une grande aile de style dit « Louis XIII », souvent appelée « le château ».
En 1925, l’ensemble est scindé : d’un côté la majorité des bâtiments et terres de ferme ; de l’autre, les Petites Écoles, l’aile de la fin du XIXᵉ siècle et le parc. L’État acquiert ce second lot en 1952 ; l’organisation du musée est confiée en 1953 et le bâtiment est inauguré comme musée national le 14 juin 1962.
Par la suite, le périmètre public s’élargit : intégration de la ferme (1983-1984 selon les actes), puis, en 2004, donation des ruines de l’abbaye à l’État, qui consacre la réunification du site sous l’intitulé « Musée national de Port-Royal des Champs » (naguère, il s’appelait « Musée des Granges ».
Le musée aujourd’hui
Installé sur les lieux mêmes de la retraite des Solitaires et des Petites Écoles, le musée conserve et présente peintures, gravures, manuscrits et documents relatifs à l’histoire religieuse, intellectuelle et artistique de Port-Royal. Pour les conditions de visite et les horaires (susceptibles de varier), se reporter au site officiel du musée : https://www.port-royal-des-champs.eu/.
Longtemps fermé pour travaux, le musée a réouvert ses portes le 20 septembre 2025.