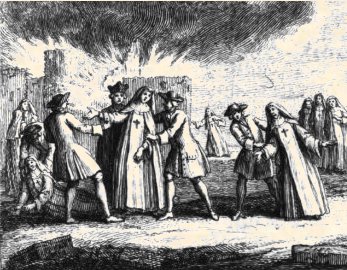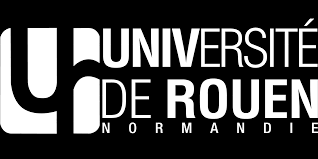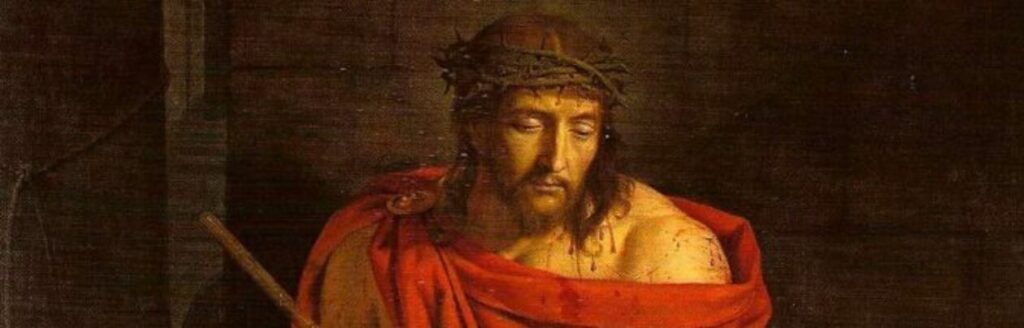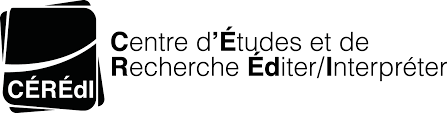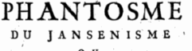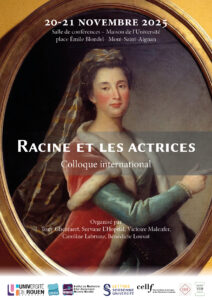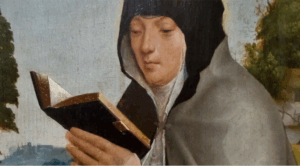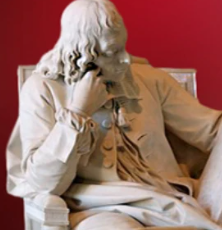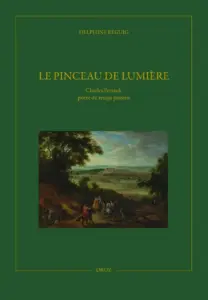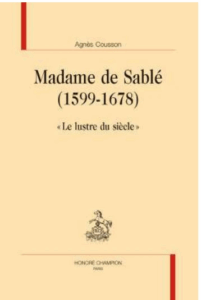Qu’appelle-t-on « jansénisme » ? D’abord un surnom polémique donné au XVIIᵉ siècle à un courant catholique de rigueur doctrinale et de spiritualité augustinienne (grâce, péché, liberté), nourri par l’Augustinus de Jansénius (1640). Pourquoi Port-Royal y est-il mêlé ? Parce que, sous l’influence de Saint-Cyran, d’Antoine Arnauld et de Pascal, le monastère est devenu l’un des foyers majeurs de ces débats. Mais le jansénisme existe-t-il ? s’agit-il d’une hérésie, d’une école théologique, ou d’une étiquette forgée par des adversaires sans contenu réel ? La controverse, qui embrase la France de Louis XIII à Louis XIV, se prolonge jusqu’à la destruction de Port-Royal des Champs (1711–1712) sans pour autant clore la question, qui rebondit au XVIIIe siècle.
Naissance du « jansénisme »
Le concile de Trente (1545-1563) a défini la doctrine de la justification (Session VI, 1547) : la grâce de Dieu est première, mais l’homme, une fois mû par la grâce, peut coopérer (foi, sacrements, œuvres). En revanche, Trente n’a pas tranché les débats techniques ultérieurs sur la nature de la grâce efficace (comment agit-elle ? quelle place exacte pour la liberté blessée ?). Ces questions enflamment ensuite la controverse dite “De Auxiliis” (fin XVIᵉ-début XVIIᵉ) entre jésuites (inspirés par Luis Molina, 1535-1600, défenseur de la liberté humaine) et dominicains (Domingo Báñez affirme l’efficacité intrinsèque de la grâce) ; Rome n’énonce pas de condamnation définitive et impose le silence, ce qui laisse le terrain ouvert aux lectures « augustiniennes » plus rigoureuses.
Dans ce contexte, Louvain (Pays-Bas espagnols) devient un foyer majeur de retour à saint Augustin (354-430), « docteur de la grâce », dont la doctrine de la justification, élaborée au gré des controverses en particulier contre Pélage, domina le Moyen-Âge. Dans les dernières années de sa vie, Augustin était devenu tenant d’une doctrine très dure, accordant à Dieu seul l’initiative du salut. Cornelius Jansenius (1585-1638), professeur devenu évêque d’Ypres, entreprend dans les années 1620 la rédaction d’une vaste somme, l’Augustinus, pour rétablir l’autorité doctrinale d’Augustin contre les dérives “semi-pélagiennes” qu’il croit déceler chez les modernes (en premier lieu le molinisme). L’ouvrage, achevé peu avant sa mort et publié à titre posthume en 1640, propose une doctrine très exigeante : misère radicale de l’homme après la Chute, dépendance entière à la grâce pour vouloir et faire le bien, et distinction serrée entre grâce “suffisante” (proposée à tous) et grâce “efficace” (qui seule opère infailliblement le consentement).
C’est à partir de là que se cristallise, en France, la ligne dite « janséniste » : elle se caractérise par une spiritualité augustinienne de la dépendance à la grâce, un soupçon envers les accommodements pastoraux. Elle ne tarde pas à subir l’accusation d’hérésie par ses adversaires, difficile à prouver, étant donné le non-dit tridentin sur la question, et un désaccord assumé jusque là de l’Église post-tridentine.
C’est dans ce contexte que parut L’Augustinus (1640).
Rédigé dans les années 1620–1630, l’ouvrage de Cornelius Jansenius (Jansénius), devenu évêque d’Ypres en octobre 1636, paraît à titre posthume à Louvain en septembre 1640. L’auteur est mort de la peste deux ans auparavant, contaminé en portant secours à ses ouailles.
La conception de la grâce selon Jansénius se développe autour de la question du premier péché d’Adam. Après la Chute, explique-t-il en s’appuyant sur Augustin, la volonté humaine est gauchie par la concupiscence : livrée à elle-même, elle se porte « infailliblement » vers l’amour de soi et des créatures. Seule la grâce donne « un cœur nouveau » et réoriente la délectation vers Dieu ; la volonté « redressée » devient d’autant plus libre qu’elle consent à ce bien supérieur. C’est la delectatio victrix : la délectation la plus forte emporte infailliblement le consentement.
Sur la liberté, Jansénius s’oppose aux schémas scolastiques dominants : la liberté n’est pas indifférence, mais spontanéité de l’amour (volonté foncière) que la grâce transforme.
Un appendice polémique, le Parallèle ou Statera, rapprochera ensuite le molinisme du pélagianisme ; il sera imprimé à part en 1647.
Rome commence par faire taire la querelle : un décret du 1ᵉʳ août 1641 interdit la controverse et la lecture des écrits « pour ou contre » l’Augustinus, dans le droit fil des débats De auxiliis.
La bulle In eminenti va plus loin: rendue publique le 19 juin 1643, condamne l’ouvrage en général, sans viser de thèses précises, dans un texte d’ailleurs remanié et peu net.
En 1653, la bulle Cum occasione condamne cinq propositions d’apparence janséniste (portant par exemple sur l’impossibilité d’accomplir certains actes vertueux sans la grâce)… mais sans affirmer qu’elles se trouvent textuellement dans l’Augustinus, Rome ne voulant pas prendre le risque de condamner saint Augustin avec Jansénius.
En France, l’Augustinus est perçu comme un retour à Augustin contre les « accommodements » modernes ; l’entourage de Saint-Cyran et d’Antoine Arnauld défend cette lecture « rigoureuse » (grâce première, dépendance radicale), sur fond d’attaques politiques et pastorales.
Quatre lignes de force se dégagent. Sur le plan anthropologique, la question est de savoir si l’homme peut coopérer au bien ou s’il dépend entièrement d’une grâce qui emporte son consentement (delectatio victrix). Du côté de la liberté, les molinistes défendent l’indifférence et l’équilibre des possibles, quand Jansénius conçoit la liberté comme un amour rectifié par la grâce. La pastorale oppose une pénitence exigeante, étroitement liée aux sacrements et à la direction spirituelle, à des pratiques jugées plus accommodantes. Enfin, l’autorité ecclésiale encadre la controverse par une discipline du débat, des condamnations prudentes et parfois ambiguës, puis par l’imposition de formulaires à signer.
Qu’on le juge « rigoureux » ou non, le pôle augustinien a nourri une pensée, une littérature, une éthique qui dépassent la scolastique : Pascal, Racine, Nicole donneront à cette exigence une portée intellectuelle et artistique durable, d’où l’attrait persistant de Port-Royal bien au-delà de ses positions théologiques.
Port-Royal dans la tourmente « janséniste »
Le basculement ne tient pas à un « coup » isolé, mais à une série de liens et d’événements qui, des années 1630 à 1643, font de Port-Royal un foyer de la controverse. Les rapports entre Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, et Cornelius Jansenius (Jansénius) sont anciens et nourris : on les voit encore conférer en 1623, et l’Augustinus reprendra dans son Liber prœmialis des lignes de réflexion proposées par Saint-Cyran dès cette date. Au plan matériel, le livre est pratiquement achevé quand Jansénius est sacré évêque d’Ypres (26 octobre 1636) ; il paraîtra à Louvain en septembre 1640.
À Port-Royal même, l’influence directe de Saint-Cyran se précise dans le milieu des années 1630 : depuis janvier 1636, il dirige huit religieuses qu’il visite tous les deux jours ; le Vendredi-Saint 10 avril 1637, il prêche le « renouvellement » pénitentiel qui marque durablement la communauté.
Le contexte politique attise la querelle. En 1636, Jansénius publie le Mars gallicus, pamphlet qui vise la politique de Richelieu (notamment son alliance avec des puissances protestantes) et contribue à braquer le pouvoir ; Richelieu fait parallèlement combattre l’Augustinus en chaire par Isaac Habert (Avent 1642-Carême 1643).
L’affrontement avec certains jésuites est plus ancien encore : dès 1625-1626, Saint-Cyran réfute la Somme théologique du père Garasse dans sa Somme des fautes (impression un temps suspendue), épisode que la tradition retient comme un prélude aux hostilités.
Le 14 mai 1638, Saint-Cyran est arrêté et incarcéré à Vincennes ; il ne recouvre la liberté que le 6 février 1643, et meurt le 11 octobre suivant des suites de sa détention. La chronologie dit assez combien la période Vincennes pèse sur Port-Royal, sans éteindre son rayonnement.
Autour de lui, la famille Arnauld se mobilise. Robert Arnauld d’Andilly, qui fut ministre, le visite quotidiennement dans sa prison. Sous son impulsion, Antoine Le Maître quitte le barreau en 1637 et attire aux Champs les premiers Solitaires quelques années plus tard ; le réseau intellectuel et spirituel se structure.
Dans ce cadre, Antoine Arnauld publie De la fréquente Communion : élaboré sous l’œil de Saint-Cyran (manuscrit sous presse en novembre 1642, approbations juin-juillet 1643), l’ouvrage paraît en août 1643 et expose en français une doctrine de la pénitence et de l’eucharistie jugée rigoureuse par ses adversaires (contre un « laxisme » dénoncé).
Dès le début des années 1640, les attaques se cristallisent : l’Augustinus est mis en vente à l’automne 1640 ; un décret du 1ᵉʳ août 1641 en interdit la controverse « pour ou contre » ; la bulle In eminenti (19 juin 1643) condamne l’ouvrage en général sans viser de thèses précises. En 1652-1653, la bulle Cum occasione frappera cinq propositions attribuées à Jansénius, sans dire qu’elles se trouvent dans le texte.
Quant au mot “jansénisme”, il s’impose alors dans les pamphlets — par exemple Le Jansénisme confondu (1652) — pour étiqueter le courant augustinien gravitant autour de Port-Royal, alors que ses partisans entendent d’abord se dire disciples de saint Augustin.
En somme, l’« affaire » de Port-Royal naît de la conjonction d’une direction spirituelle (Saint-Cyran), d’un retour savant à Augustin (Augustinus), d’un durcissement politique (Richelieu et l’affaire du Mars gallicus) et d’une pastorale exigeante (La Fréquente Communion), le tout dans un climat de contrôle romain croissant des débats sur la grâce.
En somme, l’ »affaire » de Port-Royal naît de la conjonction d’une direction spirituelle (Saint-Cyran), d’un retour savant à Augustin (Augustinus), d’un durcissement politique (Richelieu, Mars gallicus) et d’une pastorale exigeante (Arnauld, Fréquente Communion), le tout dans un climat de contrôle romain croissant des débats sur la grâce.
Le temps des Solitaires
En août 1637, le très célèbre avocat Antoine Le Maistre, dirigé de Saint-Cyran, renonce publiquement au barreau. Cette décision fit l’effet d’un « coup de tonnerre mondain. Dès décembre, il s’installe, avec son frère Simon de Séricourt, dans une petite maison attenante au monastère de Paris, tandis que Saint-Cyran oriente ses premiers pas de retraite. Au début 1638, ils sont rejoints par Antoine Singlin (bientôt directeur spirituel) et par le grammairien Claude Lancelot ; le 4 avril 1638, les autres frères Le Maistre (dont Louis-Isaac, dit de Sacy) gagnent à leur tour la « solitude ». À la demande de Saint-Cyran, le groupe commence aussitôt à instruire quelques garçons : c’est l’ébauche des Petites Écoles.
Le petit noyau, d’abord logé près de Port-Royal de Paris, gagne ensuite les Champs, dans les dépendances laissées libres par les religieuses ; les sources insistent sur le caractère inédit de cette vie laïque, quasi cénobitique, échappant à tout contrôle institutionnel. La « retraite » devient un modèle exalté par d’Andilly et la littérature spirituelle ; les solitaires peuplent le vallon de figures mythiques tout en menant des travaux matériels (essentiellement l’assainissement des marais) et intellectuels.
En 1646, les Petites Écoles s’installent au cul-de-sac Saint-Dominique (faubourg Saint-Jacques) ; au printemps 1648, pour permettre le retour des moniales, les Solitaires quittent l’enclos des Champs (une partie remonte aux Granges, ferme de l’abbaye sur le coteau), où les religieuses rétablissent la clôture le 13 mai 1648.
Le cercle s’élargit vite : Pierre Nicole (moraliste et secrétaire d’Arnauld), Nicolas Fontaine, le médecin Jean Hamon ; Blaise Pascal vient y faire retraite et participe aux grandes entreprises de Port-Royal (en particulier les conférences de Vaumurier, et le chantier de l’édition de la Bible), sans être pour autant un « Solitaire » résident.
Le pouvoir s’inquiète de cette forme de société, qui ne dépend d’aucune autorité ecclésiastique reconnue, composée de laïcs de haute volée qui n’ont pas prononcé de vœux et de quelques ecclésiastiques, unis par l’ascèse, l’étude et la direction spirituelle. De fait, les dispersions se succèdent : 20 mars 1656, première dispersion des Petites Écoles ; mars 1660, le lieutenant civil Dreux d’Aubray disperse l’École des Granges et les annexes (Chesnay, Troux) ; avril 1661, l’arrêt du Conseil impose le renvoi des pensionnaires et la fermeture des écoles.
Les grandes controverses (1643-1669)
La disparition de Richelieu ne met pas fin aux tensions : sous la Régence, Mazarin entend garder la main sur le dossier de la grâce, même si la Fronde brouille un temps les priorités. C’est à la Sorbonne que le conflit se rallume : le 1ᵉʳ juillet 1649, le syndic Nicolas Cornet fait examiner une série de thèses « sur la grâce » ; il s’agit d’abord de sept propositions visées par les antijansénistes, bientôt ramenées à cinq par la commission de docteurs divisés, qui sollicite ensuite l’avis de Rome. Le Parlement intervient à l’été 1649 pour suspendre la procédure, avant que l’affaire ne reparte sur d’autres canaux.
Le 31 mai 1653, la bulle Cum occasione du pape Innocent X condamne cinq propositions relatives aux rapports entre grâce et liberté. Contrairement à une idée reçue, ce texte ne déclare pas expressément que ces propositions se trouvent dans l’Augustinus ni qu’elles sont « de Jansénius » : cette attribution explicite ne viendra qu’avec Alexandre VII (bulle Ad sacram, 10 octobre 1656).
En France, Mazarin fait recevoir rapidement la bulle : 3 juillet 1653, le gouvernement en prend acte ; 4 juillet, lettres patentes l’érigent en loi du royaume. Une réception plus solennelle par l’épiscopat suit (réunion au Louvre les 26–28 mars 1654). Quelques voix gallicanes (Gondrin, évêque de Sens; Henri Arnauld, évêque d’Angers); Buzenval, de Beauvais, et Choiseul (évêque de Comminges) protestent ou nuancent, mais l’orientation générale est à la soumission.
Pour Port-Royal et ses amis, c’est un premier revers majeur. La polémique gagne désormais l’espace public : en décembre 1653 paraît un almanach pour 1654, La déroute et confusion des jansénistes, dont la gravure montre Jansénius brandissant l’Augustinus et des « jansénistes » se jetant dans les bras de Calvin ; tiré à 16 000 exemplaires selon la police, le placard popularise le terme de « jansénisme » en l’assimilant sommairement au calvinisme.

Après la bulle Cum occasione (1653), Antoine Arnauld tente une contre-offensive décisive. Dans sa Seconde Lettre à un duc et pair (10 juillet 1655), il introduit la distinction fameuse du « droit » et du « fait » : d’accord pour condamner, en droit, les Cinq Propositions au sens où Rome les réprouve ; mais contestation, en fait, qu’elles se trouvent dans l’Augustinus. Cette ligne de crête, qui lui permet d’affirmer son obéissance doctrinale tout en résistant sur l’exégèse du texte de Jansénius, devient l’argument matriciel du parti augustinien .
La riposte institutionnelle ne tarde pas. Le 31 janvier 1656, Arnauld est censuré par la Sorbonne ; il sera formellement exclu le 15 février, tandis que la censure est étendue, en mars, aux docteurs qui refusent de s’y soumettre. Le dossier montre aussi, dès la mi-janvier, la protestation d’une soixantaine de docteurs favorables à Arnauld, signe de la brutalité de la procédure.
Arnauld se met alors à couvert et gagne les Champs pour préparer sa défense ; Pierre Nicole devient son bras droit de plume, multipliant mémoires et traités destinés à démontrer que le « jansénisme » n’est qu’une « hérésie imaginaire » forgée par les adversaires. Dans la même séquence, Pascal jette dans l’arène ses Lettres provinciales : la première paraît le 23 janvier 1656, la dix-huitième porte la date du 24 mars 1657 ; ces brochures, diffusées clandestinement puis partiellement mises en vente, frappent l’opinion par leur verve et leur pédagogie, sans pour autant infléchir la mécanique répressive .
Le règne personnel de Louis XIV (mars 1661) durcit encore le dispositif : l’Assemblée du clergé décide la signature obligatoire d’un Formulaire condamnant les Cinq Propositions, et un arrêt du Conseil (13 avril 1661) en impose l’exécution à tout le clergé, religieux et religieuses compris . À Port-Royal, l’archevêque Hardouin de Péréfixe met la maison en demeure de signer : interdiction des sacrements (21 août 1664), puis enlèvement de douze religieuses (26 août), mesures encore renforcées en novembre-décembre. Au terme de ces coups de force, seules onze sœurs, les « signeuses », se rallient ; en juillet 1665, Péréfixe regroupe aux Champs toutes les non-signataires, sous surveillance et privées des sacrements, tandis que les « signeuses » conservent Port-Royal de Paris avec personnalité juridique et, dès février 1666, la jouissance des biens du monastère (moyennant pension aux exilées des Champs) .
En filigrane, l’image de Port-Royal comme « défenseur » d’une liberté de conscience tient à cette stratégie du « droit » et du « fait » : ils proclament leur loyauté doctrinale, et revendiquent la souveraineté de la lecture, d’où un conflit durable entre obéissance requise par l’autorité ecclésiale et exigence de probité intellectuelle devant les textes.
La paix de l’Eglise (1669-1679)
Après les foudres du Formulaire, la persécution connaît près d’une décennie d’accalmie. Sous Clément IX (élu en 1667), Rome cherche l’apaisement; Louis XIV, mobilisé par ses ambitions extérieures, y voit l’intérêt d’un armistice intérieur. En 1669, une série de brefs pontificaux ouvre la « Paix de l’Église » : on admet des signatures sans scruter les consciences (sous condition d’un « silence respectueux » sur la question de savoir si les thèses condamnées sont dans Jansénius), à charge de ne plus rallumer la querelle.
Ce répit (le « bel automne de Port-Royal », disait Sainte-Beuve) permet aux Solitaires de réapparaître autour des maisons, et au monastère de respirer, tant qu’il s’abstient de polémique. Les « Messieurs » se tournent vers des travaux d’enseignement, de controverse antiprotestante et de piété littéraire : on publie en 1671 un Recueil de poésies chrétiennes et diverses.
Le rayonnement est alors considérable. Boileau et Mme de Sévigné fréquentent ou soutiennent le milieu ; Racine, un temps brouillé, se rapproche ; La Fontaine compose (à la demande de d’Andilly) une Vie de saint Malc en vers. L’austérité des mœurs n’empêche pas l’attrait intellectuel et mondain du vallon, bien au contraire.
Surtout, l’entreprise majeure est la traduction de la Bible. Le Maistre de Sacy a déjà donné le Nouveau Testament (édition dite de Mons, 1667) ; à partir de 1672, il lance les volumes de l’Ancien Testament. L’ensemble, poursuivi et achevé après sa mort intervenue en 1684, formera la « Bible de Port-Royal », qui marquera durablement la prose religieuse française et sera lue par Voltaire, Flaubert, et Rimbaud. (On la trouve facilement aujourd’hui en collection Bouquins, dans une édition procurée par Philippe Sellier).
L’hiver de Port-Royal (1679-1710/1713)
À la mort de la duchesse de Longueville (15 avril 1679), protectrice du monastère, s’achève le « bel automne » de Port-Royal. Le 16 mai 1679, sur ordre du roi, l’abbaye des Champs perd le droit d’accueillir des novices ; postulantes et pensionnaires sont renvoyées, et les ecclésiastiques présents, ainsi que les « Messieurs », doivent quitter les lieux. La communauté entre alors dans un déclin irréversible. Quelques semaines plus tard (18 juin), Antoine Arnauld part pour les Flandres et s’installe à Bruxelles, où Pierre Nicole le rejoint provisoirement. Arnauld meurt à Bruxelles en 1694 ; Nicole s’éteint l’année suivante.
Au tournant du siècle, l’affaire Quesnel rallume la répression : arrêté à Bruxelles le 30 mai 1703, Pasquier Quesnel se voit confisquer ses papiers, bientôt déposés à Paris ; l’épisode nourrit l’idée d’un réseau clandestin janséniste et durcit la politique royale. À Rome, Clément XI condamne ensuite, par la bulle Vineam Domini (16 juillet 1705), le « silence respectueux » sur la question de fait, rendant inopérante l’ancienne échappatoire janséniste. En France, les religieuses des Champs donnent bien leur signature (21 mars 1706), mais en l’accompagnant d’une réserve « sans déroger » à la Paix clémentine ; Louis XIV s’en irrite, interdit toute nouvelle novice et, après la mort de l’abbesse (20 avril 1706), le cardinal de Noailles défend d’en élire une autre.
La sévérité s’accroît encore en 1707 : dès l’automne, Noailles confirme par écrit le refus de la communion (3 octobre) puis, par une ordonnance du 18 novembre 1707, déclare les religieuses « incapables de participer aux sacrements de l’Église ». Sollicitée par le roi, Rome supprime ensuite Port-Royal des Champs : la bulle Ad instantiam regis (27 mars 1708) transfère ses biens à Port-Royal de Paris. Le 11 juillet 1709, Noailles prononce l’ »extinction » de l’abbaye ; par arrêt du 26 octobre, le Conseil d’État ordonne la dispersion des religieuses. Le 29 octobre 1709, le lieutenant général de police d’Argenson exécute la lettre de cachet : quinze professes et sept converses sont enlevées et envoyées en exil, maison par maison.
La démolition matérielle suit de près : un arrêt du 22 janvier 1710 ordonne de raser les bâtiments des Champs. Les travaux, qui s’étalent de janvier 1710 à juin 1713, s’accompagnent d’exhumations qui marqueront durablement les mémoires et nourriront le mythe de Port-Royal martyr. La clôture doctrinale arrive presque en même temps : la bulle Unigenitus (8 septembre 1713) condamne 101 propositions tirées des Réflexions morales de Quesnel, scellant la défaite du premier jansénisme.

Naissance d’un mythe
La bulle choque bien au-delà du cercle « janséniste » : Carmona souligne l’indignation d’une large opinion (curés, réguliers, magistrats), et le bras de fer entamé pour « faire recevoir » la bulle comme loi du royaume dès 1714, sous l’impulsion du père Tellier, provoque une cascade de résistances, menées en particulier par le cardinal de Noailles.
Dans ce climat naissent les « Appels au futur concile » et le mouvement des « appelants » : listes, ré-appels, écrits polémiques circulent, relayés par le journal clandestin du parti, Les Nouvelles ecclésiastiques.
Très vite, la querelle quitte les seules chaires et facultés : elle gagne la rue et les cimetières. Après la mort du diacre François de Pâris (1727), sa tombe à Saint-Médard devient foyer de pèlerinage et de « convulsions », phénomène qui divise jusqu’aux amis de Port-Royal.
D’autres pèlerinages ont lieu. Malgré la dispersion des religieuses et l’arasement du monastère (1711-1712), Port-Royal s’impose alors comme « lieu de mémoire ». Philippe Luez montre comment, au XVIIIᵉ siècle, pèlerinages discrets, publications (Nouvelles ecclésiastiques mais aussi les grandes histoires de Clémencet) et la lutte prolongée contre Unigenitus entretiennent une mémoire militante ; au tournant des Lumières et de la Révolution, l’abbé Grégoire hisse les Ruines de Port-Royal-des-Champs au rang de symbole. Au XIXᵉ siècle, Sainte-Beuve fixe définitivement le mythe de Port-Royal : un récit de grandeur spirituelle et de martyre, qui aimante érudits, écrivains et public cultivé.
En somme, après la bulle Unigenitus, la querelle se déplace : de la théologie (grâce, liberté, Église) vers l’espace social et politique (appel au concile, presse clandestine, tribunaux, police des foules), puis vers la mémoire et la littérature. C’est dans ce glissement que s’invente la postérité de Port-Royal : d’un monastère, on a fait une cause ; d’une cause, une histoire ; et de cette histoire, un mythe tenace.