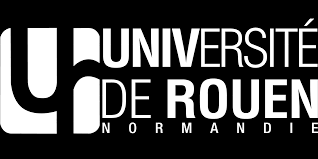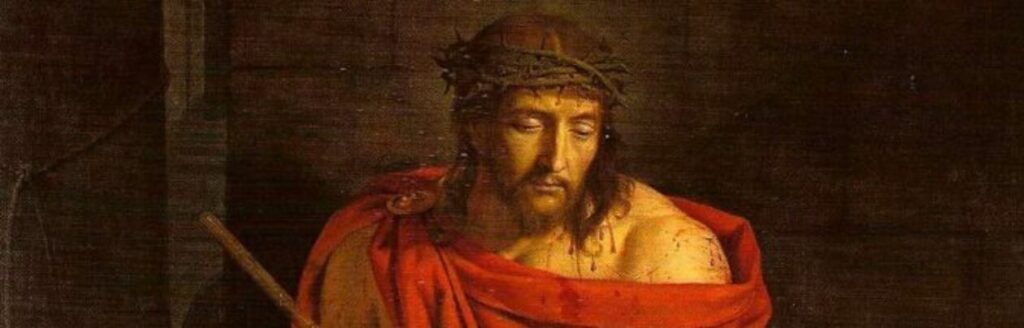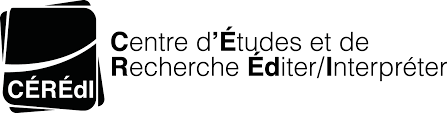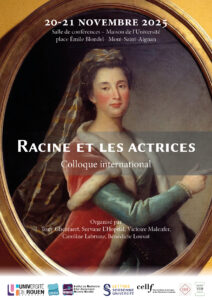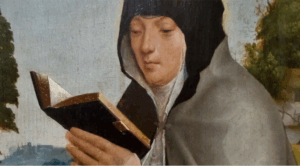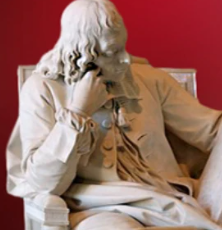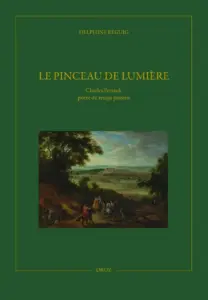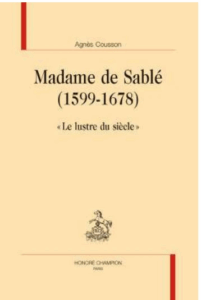À la fin de 1637, la mort de Catherine de La Boderie, épouse de Robert Arnauld d’Andilly (23 août 1637), provoque dans le clan Arnauld un choc spirituel dont Antoine Le Maistre (1608-1658), jeune avocat déjà célèbre, fait l’occasion d’une « retraite du monde ». Dès 1637-1638, Port-Royal voit ainsi se former, à côté de la communauté cistercienne, un groupe d’hommes retirés du monde sans appartenir à aucun ordre : les « Solitaires ». Le Maistre est bientôt rejoint par son frère Simon (dit Séricourt) sous la direction spirituelle de Saint-Cyran ; le renoncement public de ces jeunes gens de la meilleure société fait grand bruit et met Port-Royal dans la lumière.
Installé alors près du cloître des Chartreux, Saint-Cyran suit de très près la formation de ses disciples ; Le Maistre lui-même témoigne qu’il allait ‘tous les jours » au cloître des Chartreux pour l’étude (notamment l’hébreu). Saint-Cyran fixe finalement Antoine Le Maistre et son frère dans l’orbite de Port-Royal : Port-Royal de Paris d’abord, puis Port-Royal des Champs où Antoine se fixe pour toujours en août 1639. Leur cadet Louis-Isaac (le futur « de Sacy ») les rejoindra et sera ordonné prêtre en 1649.
À partir des années 1640, d’autres hommes (magistrats, lettrés, officiers, ecclésiastiques) gagnent le « désert » des Champs. Le groupe qu’on appellera les « Solitaires » (ou « Messieurs de Port-Royal ») occupe un espace mouvant entre retraite stricte et engagements « dans le monde » : certains enseignent, voyagent, publient, se cachent pendant les persécutions, d’où la difficulté (déjà notée par les contemporains) de tracer une frontière nette entre « Solitaires » et « Messieurs ». Le terme de « Messieurs », qui s’impose dans les échanges, dit bien la singularité de cette expérience, sociale et spirituelle : des laïcs (ou quelques clercs) vivant en fraternité, au seuil du cloître, et pourtant en dehors de tout vœu régulier.
Leur régime de vie, publié au milieu des années 1640 (La conduite et des exercices des pénitents solitaires), conjugue prière, étude et labeur manuel. Plusieurs enseignent et rédigent des méthodes (langues, grammaire, logique), ou travaillent aux grandes entreprises savantes de Port-Royal (traductions bibliques, controverses, histoire ecclésiastique). Le Maistre de Sacy, par exemple, devient le maître d’œuvre de la Bible française dite « de Port-Royal ». La pédagogie des Petites Écoles (classes réduites, méthodes neuves, primat du français) s’élabore dans ce milieu ; on y croise Claude Lancelot, Pierre Nicole, Jean Hamon ou encore (comme élève) Jean Racine. Cette insertion intellectuelle n’efface pas l’idéal de retrait : nombre d’entre eux vivent à la dure, cultivent, copient, relient, jardinent (ainsi François Bouilly), selon une économie de sobriété et de service. La discipline ascétique n’exclut d’ailleurs pas l’humilité concrète : la tradition rapportée par Sainte-Beuve raconte que M. de La Petitière, ancien « homme d’épée », voulut « s’abaisser jusqu’à faire des souliers pour les religieuses » ; on cite aussi Antoine Baudry de Saint-Gilles d’Asson, ancien étudiant en Sorbonne, vivant pauvrement et travaillant le bois.
Lorsque les religieuses regagnent l’abbaye restaurée (1648), les Solitaires s’installent sur le plateau agricole des Granges, relié à l’abbaye par l’escalier dit des « Cent-Marches », tracé pour faciliter la descente aux offices. Là s’affermissent la vie d’étude, les traductions, les éditions et l’enseignement des Petites Écoles (bâtiments construits en 1651-1652).
Numériquement, le phénomène reste modeste mais marquant : on compte, sur tout le XVIIᵉ siècle, environ quatre-vingt-dix ralliements; jamais plus d’une douzaine de Solitaires ne sont présents en même temps aux Champs. Si le groupe a été dénoncé par ses adversaires comme « subversif » en raison des controverses jansénistes, il est composé majoritairement de laïcs pieux, fidèles aux sacrements, auxquels se joignent quelques ecclésiastiques (ainsi Le Maistre de Sacy, directeur spirituel après 1649). Leur originalité tient moins à des vœux formels qu’à une pratique communautaire de l’Évangile, nourrie des Pères, et ordonnée à la charité, à la vérité et à l’éducation.
Aux yeux du pouvoir, cette frange non encadrée inquiète : quand se tend la crise janséniste, les Solitaires sont périodiquement dispersés. En 1660 déjà, la persécution force certains à quitter le « désert »; plus largement, les mesures d’interdiction et d’exil rythment la décennie 1650-1660 avant un relatif apaisement, puis de nouvelles vagues jusqu’à la fin du siècle.
En définitive, les Solitaires de Port-Royal ne fondent pas un ordre ; ils inaugurent, à l’ombre d’un monastère réformé, une forme de vie chrétienne laïque, commune, disciplinée et intellectuellement très active. C’est l’une des raisons de leur postérité : ils offrent un modèle « original » de vie évangélique pour gens du monde, qui a fasciné leurs contemporains et contribué à faire de Port-Royal un lieu singulier de la modernité dévote.
Repères biographiques et terminologiques utiles
- Antoine Le Maistre (1608-1658) : premier des Solitaires, retraite décidée en 1637, établissement définitif aux Champs en 1639.
- Simon Le Maître, sieur de Séricourt : frère d’Antoine ; avec lui au noyau initial des reclus.
- Louis-Isaac Le Maistre de Sacy (1613-1684) : leur cadet, futur prêtre (1649) et traducteur de la « Bible de Port-Royal ».
- Solitaires / Messieurs : désigne un même milieu de retraitants, plus ou moins retirés, partageant la prière, l’étude et les œuvres (écoles, éditions), sans nécessairement appartenir à un ordre religieux.